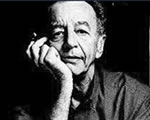 Rien n’est plus dangereux que l’Avant-gardiste acculé dans ses retranchements dorés. Ce ne sont pas des valeurs qu’il défend, ce sont des intérêts. Pour un peu, il en oublierait d’être poli. Attaqué, on le voit se raidir en accusant ses adversaires de raideur.
Rien n’est plus dangereux que l’Avant-gardiste acculé dans ses retranchements dorés. Ce ne sont pas des valeurs qu’il défend, ce sont des intérêts. Pour un peu, il en oublierait d’être poli. Attaqué, on le voit se raidir en accusant ses adversaires de raideur.
Notable comme il y en eut rarement parmi les artistes, il traite les autres de notables. Créateur officiel, protégé, survivant dans une tiède sécurité, il continue à revendiquer pour lui-même la flamme, la nouveauté, la hardiesse de la recherche, la fraîcheur de l’inexpérience fracassante, I’audace, le charme, la spontanéité pimpante et fringante.
Nanti, il tient absolument à passer pour maudit. Sa force inusable, c’est son insolence.
Bien sûr, il n’y a plus que lui qui s’imagine encore qu’il transgresse quelque chose en “faisant parler” le corps, en “déconstruisant” la langue ou en “provoquant” le marché de l’art par ses exhibitions ; mais ne le lui dites pas, ça lui ferait de la peine. Il dure depuis si longtemps avec la certitude confortable que la lutte de l’innovation contre la tradition est la condition du principe de développement de la société, et se solde automatiquement par la déroute ridicule de la tradition ! C’est tout ce qui lui est resté du marxisme évanoui, cette croyance attendrissante que “le nouveau est invincible”, qu’il a l’avenir pour lui et le vent de l’Histoire dans les voiles. Du coup, si on fait mine de l’attaquer, c’est un sacrilège, un affront-inqualifiable. Un crime qui va bien plus loin que l’avant-garde elle-même : rien qu’en le critiquant, c’est toute l’humanité qu’on risque de priver de ses raisons d’espérer.
D’ailleurs, et par principe, l’Avant-gardiste couronné ne devrait même pas avoir à se défendre : le Dieu du Nouveau garantit sa qualité. Qu’il se veuille artiste, littérateur, musicien, plasticien ou poète, l’Avant-gardiste puise sa confiance dans un manichéisme spontané : cette guerre du Nouveau contre l’Ancien, par laquelle il explique le monde et légitime son existence, c’est Ormuzd contre Ahriman. Le Nouveau triomphant systématiquement de la Malfaisance.
C’est pour ça qu’il est toujours de très mauvaise humeur quand on le met en doute. Ce ne sont pas ses oeuvres qu’on menace, c’est son image, sa renommée bien établie de champion du dépassement. Sa réputation de franchisseur de frontières. Malgré le nombre pharamineux d’entreprises déstabilisatrices, toutes plus brillantes les unes que les autres, à travers lesquelles il s’est illustré, il garde la foi, au moins, dans une cohérence : celle de l’Histoire à son égard. Elle ne saurait se comporter immoralement avec lui, ce serait le monde à l’envers. La nécessité de répondre à ses détracteurs n’est donc, à son sens, que du temps perdu. Pour lui, les jeux sont faits. La partie est gagnée. Ces attaques d’arrière-garde le fatiguent d’avance.
Chevalier du négatif, professionnel de la perversion, fonctionnaire de l’ambigu et de la subversion, ses moyens comme ses buts ont toujours été moralement irréprochables : l’égalité des chances, la justice sociale, les droits de l’homme, il les a imposés jusque dans les arts. Avec une radicalité qui fait plaisir à voir. Une austérité qui force le respect. Où qu’il ait choisi de briller, quelque discipline qu’il ait investie, il se flatte d’abord de ne pas flatter les sens. La complaisance n’est pas son fort. Ni le divertissement, cet ennemi du sérieux, donc du douloureux.
Romancier, on l’a connu chassant des fictions le personnage de roman, l’épurant de ce prétexte bourgeois, de cette prothèse dépassée, au profit du mouvement de phrase éclaté ou du déplacement des sujets dans la narration suspendue. Peintre, on a pu l’applaudir étalant ses déchets plus ou moins recyclés, métaphores cinglantes de la fécalité, donc du marché de l’art (voir “le désolant Cy Twombly”, comme écrit Duteurtre, jetant “quelques vilaines taches en se réclamant de Poussin”). Musicien, enfin, il s’appela Boulez ou Stockhausen, et croisada sans faiblesse, dans les années 50, contre le système tonal, ses hiérarchies, ses sélections foncièrement inégalitaires, son monarchisme esthétique. Ce fut la glorieuse nuit du 4 août de la musique, l’abolition des échelles sonores comme des privilèges d’un autre âge, de vieilles armoiries peintes sur des carrosses.
Rien n’a jamais résisté à l’Avant-gardiste radical. Après avoir rêvé, un peu bovaryquement, du fond de sa province et de sa condition modeste, aux grandes ruptures héroïsées des cinquante premières années du siècle, il lui a été donné, le temps venu, de les rejouer en farce triste mais agréée. La réalité médiocre de ses origines l’avait enragé, comme Yonville l’Abbaye enrageait cette pauvre Emma. Rimbaud, Picasso, Duchamp, Artaud ou Schönberg lui paraissaient les seigneurs d’un monde supérieur. Il s’est promis qu’un jour il ferait partie de ce monde. En d’autres périodes, cette volonté d’inclure son rêve dans la réalité aurait peut-être rencontré certaines résistances. Mais notre époque est celle où la réalité a cédé, comme un plancher s’écroule. Il en a profité. Pour la première fois, le rêve a triomphé dans la réalité même. Il s’est installé partout. Le désir n’a même pas été pris pour la réalité, comme l’exigeait le catéchisme de 68 ; il a pris la place de la réalité retombée à la friche.”
Merci Spoon




