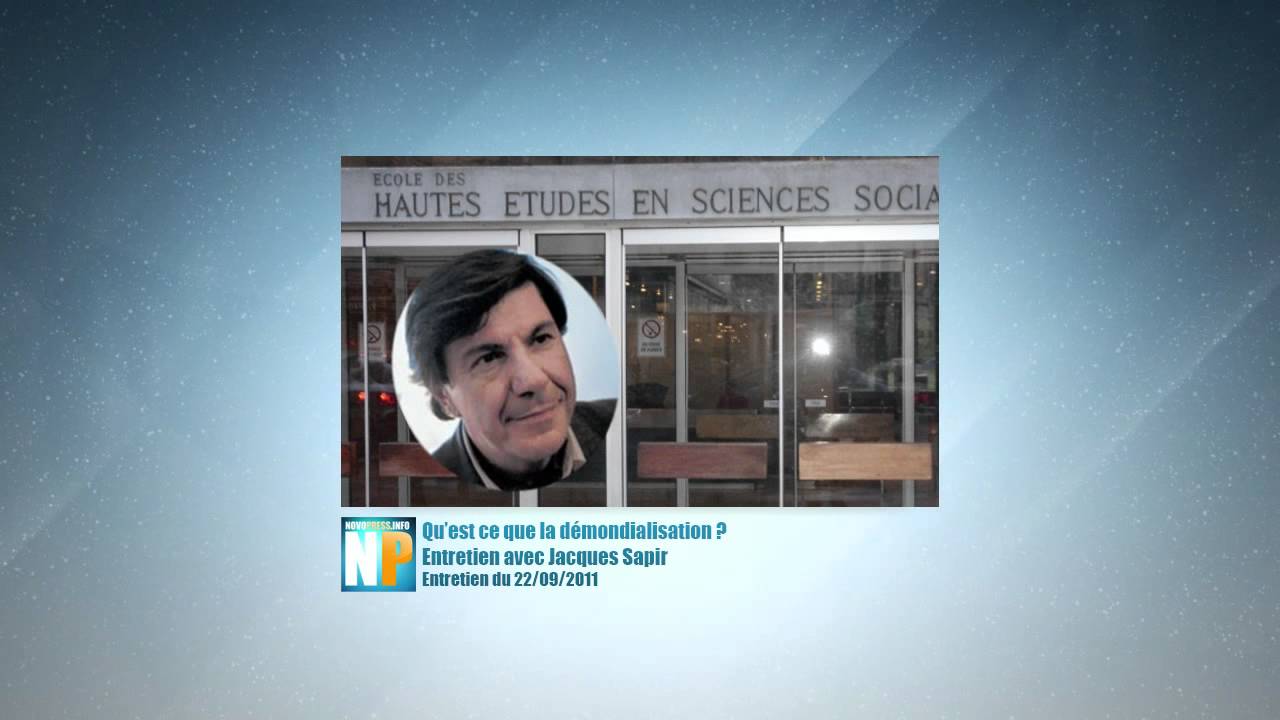L’annonce de la fermeture par Novartis de son site de Prangins [en Suisse] pose la question entre le commerce et la citoyenneté. L’économie mondiale est-elle déliée de tout rapport avec le local ? Cette idée, qui a germé au XVIIIe siècle, s’impose aujourd’hui avec force. Mais elle n’est pas inéluctable.

L’opposition entre citoyenneté et acteur économique n’est-elle pas une caractéristique majeure de notre temps ? Et pourtant cette manière de voir date du XVIIIe siècle. Elle a été formulée par Adam Smith, qui annonce ainsi l’ouverture au monde grâce à l’économie marchande.
Ce bref préambule devrait permettre de faire quelques observations liées à l’annonce, par la firme multinationale Novartis, d’une suppression massive d’emplois sur un même lieu de production (LT du 26 octobre 2011). Il est certes possible et nécessaire de s’indigner, en évoquant des règles morales ou des principes juridiques (LT du 28 octobre). Est-ce pourtant suffisant pour s’opposer intellectuellement à la normalité d’un savoir économique apparemment souverain ?
Nul doute qu’il devient toujours plus difficile de se libérer de la nécessité contraignante des marchés financiers, largement perçus comme le modèle qui devrait fonder la structure régulatrice d’un capitalisme libéral. Nombre d’entreprises, à travers la recherche du plus grand profit possible, sont amenées à maximiser la répartition des dividendes aux actionnaires, au détriment d’autres obligations à l’égard des employés et plus largement de la collectivité dans son ensemble.
Tenter de comprendre pourquoi ce capitalisme s’impose aujourd’hui avec une telle force devrait reposer sur des données historiques. Une rapide plongée dans les siècles précédents montre que l’idée de faire du monde entier un seul espace économique n’est en rien nouvelle. N’est-elle pas constitutive du projet même de la modernité ? Une idée qui renvoie à une manière spécifique de concevoir l’être humain comme tel et dans ses rapports nécessaires avec la nature et avec les autres. En d’autres termes, ce sont des fondements normatifs particuliers qui justifient la dynamique capitaliste. Quelques exemples pour illustrer une telle affirmation.
Déjà à la fin du XVIIe siècle, un auteur comme Dudley North considère que « du point de vue du commerce, le monde entier n’est qu’une seule nation ou qu’un seul peuple, à l’intérieur duquel les nations sont comme des personnes ».
Dans la même perspective et à la même époque, l’italien Montanari confirme que « les communications des peuples entre eux sont si étendues sur tout le globe terrestre que l’on peut quasiment dire que le monde entier est une seule ville, où se tient une foire permanente de toutes les marchandises et où tout homme, sans sortir de chez lui, peut au moyen de l’argent s’approvisionner et jouir de tout ce que produisent la terre, les animaux et le labeur humain ».
Près de soixante ans plus tard, Montesquieu ne pourra que confirmer une telle position mondialiste. Ainsi « […] toutes les marchandises appartiennent au monde entier, qui, dans ce rapport, ne compose qu’un seul Etat, dont toutes les sociétés sont les membres ».
Cette vision d’un monde économique pour lequel déterritorialisation et délocalisation sont des processus naturels est exprimée tout particulièrement par Adam Smith, avec un grand souci de clarté. Pour lui, en effet, « un marchand n’est nécessairement citoyen d’aucun pays en particulier. Il lui est, en grande partie, indifférent en quel lieu il tienne son commerce, et il ne faut que le plus léger dégoût pour qu’il se décide à emporter son capital d’un pays à un autre, et avec lui toute l’industrie que ce capital mettait en activité ».
Aujourd’hui une telle mobilité planétaire des forces économiques et financières est posée comme la condition pour promouvoir une croissance économique, propre à engendrer une augmentation généralisée des emplois en en conséquence du bien-être. Nous devons pourtant constater une rupture radicale entre le sort de grandes entreprises et celui de leurs employés.
A suivre le World Economic Forum, en 1996 déjà, « autrefois des profits plus élevés signifiaient plus de sécurité de travail et de meilleurs salaires. La manière dont les compagnies transnationales doivent opérer, pour entrer en concurrence dans l’économie globale, signifie que c’est une routine maintenant que des compagnies annoncent à la fois un nouvel accroissement des profits et une nouvelle vague de licenciements ».
Dans cette atmosphère généralisée de libéralisation, de privatisation et de déréglementation, la notion de compétitivité occupe incontestablement une place centrale dans le discours dominant. Elle apparaît comme le maître mot de notre époque et comme l’impératif catégorique d’un libéralisme global. Etre compétitif, à l’échelle englobante de la planète, est vu comme le seul mode viable de régulation des hommes et des sociétés. Une compétitivité déterritorialisée qui ne s’inscrit plus guère dans un espace politiquement et socialement défini.
Du point de vue des travailleurs, l’idée même de compétitivité se trouve exprimée dans d’autres termes devenus courants comme mobilité et flexibilité, ou même employabilité. Ce qui tend à réduire toute personne à une stricte fonction productive assimilable à un « capital humain ». Mais qu’advient-il de ceux qui ne sont pas, ou ne sont plus utiles, ou n’arrivent pas à faire valoir leur utilité sur le marché du travail ?
Faut-il penser que les nécessités impérieuses d’une économie rationalisée supposent un mouvement inéluctable ? Voilà une croyance ancrée dans les esprits, au point de voir dans le capitalisme un ordre naturel. Nous serions donc pris dans un processus contre lequel il serait impossible de lutter. Bienfait pour les uns, malgré le prix à payer. Une impasse pour les autres, préfigurée en quelque sorte par la spirale destructrice du chômage, des formes diverses d’exclusion et de l’enrichissement illimité d’une minorité face à une pauvreté dégradante.
Le poids de l’histoire et l’intériorisation des valeurs culturelles liées à la sphère économique seraient-ils si puissants, au point d’imaginer qu’aucune alternative ne puisse être envisageable ? Les seules finalités vraies et justes de la vie humaine doivent-elles se réduire essentiellement à une quête illimitée de la richesse, soumise à l’exigence d’une maîtrise toujours plus poussée de la nature, de l’être humain et de la société ?
C’est dire qu’une réflexion sur l’existence simultanée de licenciements et de profits substantiels devrait sans doute commencer par une interrogation en profondeur sur l’impensé d’une économie dans sa prétention à détenir la vérité et la normativité sur la vie humaine.