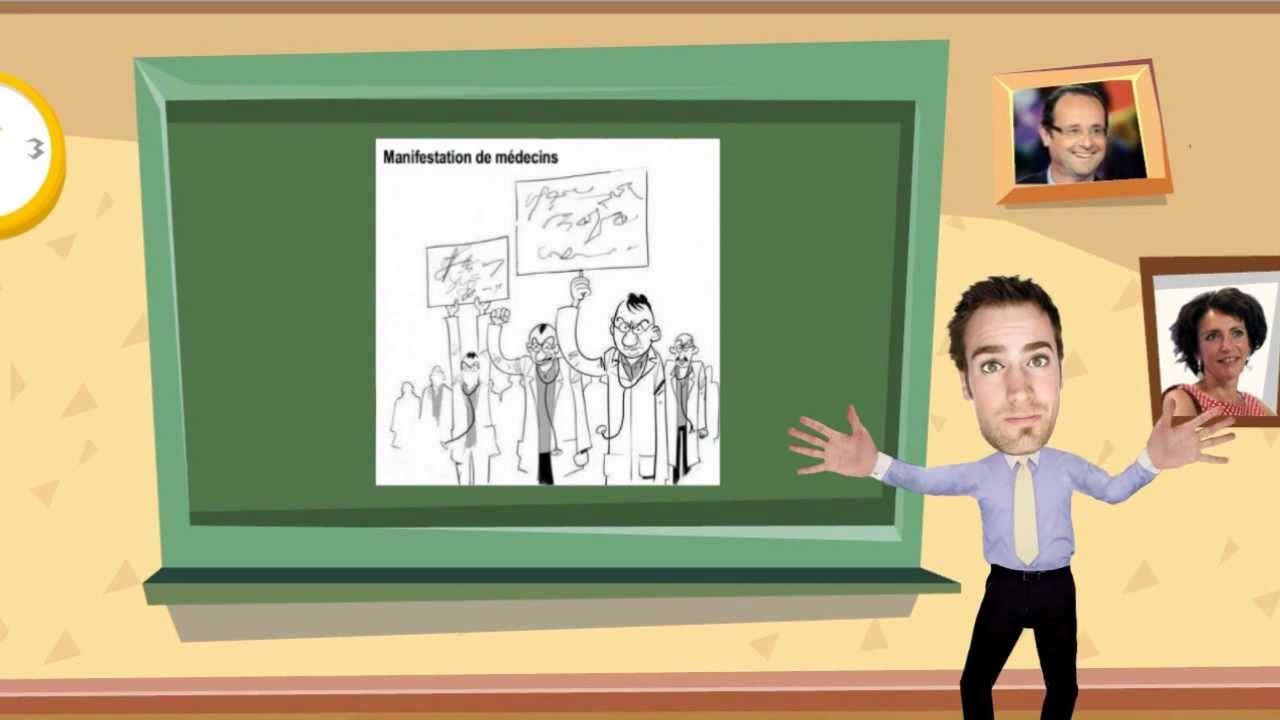J’ai fini de saisir sur mon PC le manuscrit des mémoires de guerre de mon arrière grand-père agé de 20 ans en 1914. Ce texte inédit était destiné uniquement à ses enfants. Comme beaucoup de poilus, il ne parlait jamais de la guerre. Ce texte en est son seul témoignage. Vous êtes les premiers étrangers à ma famille directe à le lire. (N’hésitez pas à signaler les fautes de frappes ou les erreurs concernant les noms de villages… Et si vous pouvez apporter des précisions sur les différentes batailles ou endroits mentionnés…)
8/9/1914
Il faut en premier lieu bien tenir compte de la mentalité du Français. A part quelques exceptions, nous étions de grands patriotes. Depuis notre enfance on nous avait enseigné la haine de l’Allemand, qui nous avait pris l’Alsace et la Lorraine et 1870-71. Nous voulions la récupérer. Ca qui va suivre ne sera qu’une suite de petites anecdotes personnelles qui n’ont eu d’importance que pour moi, mais qui n’ont rien à voir avec la conduite de la guerre que nous ne connaissions pas nous autres « poilus ». Dans notre petite sphère, nous ne savions rien, à peine connaissions-nous les unités qui se trouvaient à quelques kilomètres de nos positions de batterie.
Le 8 septembre 1914, nanti d’un ordre d’appel, je rejoignais le 3e régiment d’artillerie à pied de Cherbourg – Quartier « Martin Despallière ». Nous étions quinze cents dans un ancien monastère transformé en caserne. Naturellement, pas de lits militaires, on nous distribua des enveloppes de paillasse et nous allâmes les remplir de paille dans une grange. Ensuite, répartition dans les chambrées.
Je m’inscrivis au peloton des élèves-brigadiers. Instruction sans histoire : artillerie, théorie.
Je fus nommé moniteur d’éducation physique suite à un passage dans la section de préparation militaire.
Nous n’étions pas mal au Dépôt, sauf pour la nourriture qui n’était pas brillante.
Il n’y avait pas de réfectoire, nous avions reçu chacun une cuillère, c’est tout.
Nous étions 1500 mais il n’y avait que huit cents gamelles. Des baquets remplis d’eau chaude étaient prévus pour le nettoyage des gamelles par ceux qui les avaient envoyées. Malheureusement, l’eau était vite sale et les camarades les jetaient en vrac prêts des baquets. Etant au peloton, nous mangions les derniers dans des gamelles plutôt sales, les cuisiniers n’ayant pas le temps de les nettoyer. Mais à vingt ans, on n’est pas difficile. Nous mangions, quand il faisait beau, assis contre les mûrs dans la cour du quartier, les jours de pluie assis sur les paillasses dans les chambrées.
A la fin de 1914, passage de l’examen de sortie du peloton. Je fus reçu premier. Ce résultat me permettait de rester au Dépôt comme instructeur, mais je voulais aller au front, car j’avais peur que la guerre se termine avant mon arrivée ! Je m’inscrivais comme volontaire pour le prochain départ qui eut lieu le 20 janvier 1915.
Voyage sans histoire, débarquement à Frouard, où nous trouvâmes trente cm de neige. Etape à pied de Frouard à Sivry, petit pays à 20 km de là. Il faisait froid, nous étions logés dans un grenier où pas mal de tuiles manquaient. Comme il n’y avait pas assez de couvertures pour tout le monde, on les avait coupées en deux. Avec un grand corps comme le mien quand j’avais le nez sous le couvre-pied, les pieds dépassaient et vice-versa.
Je fus versé comme chef de pièce à une section de 120mm long Debange modèle 1877. (1)
Quelques temps après je passais au 155mm long mais comme brigadier observateur. (2)
En février, nous partîmes à Pont à Mousson exactement dans la Forêt de Facq, faire une attaque sur le signal de Xon. De mon observatoire, situé à côté de Mousson, on avait une vue allant jusqu’à Metz. (4)
De retour, nous nous mîmes en batterie dans le bois de la Fourrasse, près de Jeandelaincourt.
Mon observatoire était tantôt dans un arbre recouvert d’une blouse bariolée, tantôt dans la tour de Noméry sur les bords de la Seille (5). Secteur très calme jusqu’en juillet 1915.
Nous partons de là avec une batterie de 155 long & débarquons à Sormmessons. Nous allons à pied jusqu’à la ferme de Jonchery, sur les bords de la Suippe, entre Suippes et Mourmelon.
La première nuit, on nous fait installer nos tentes individuelles par groupe de six. Peu de place pour chacun ! Dans la nuit, un orage se leva et toutes nos tentes s’envolèrent.
Pas gaie, je vous l’assure, cette nuit sous la flotte.
L’Etat-major fit installer des batteries se touchant, le long et en avant de la Suippes. On nous avait fait préparer des plateformes surélevées pour augmenter d’un km la portée des canons. Le 25 septembre, l’attaque fut déclenchée. Ce fut lamentable. Nous devions aller à Saint-Soupplet (6). Alors que nous étions à six km en avant de Saint-Hilaire-Le-Grand, notre progression fût stoppée.
Pour évacuer les blessés sur des brancards à deux roues, le Génie avait creusé de larges boyaux. Comme il nous fallait passer sur ces boyaux, on avait doté les batteries de ponts en poutrelles de fers sur lesquels un canon de 75 n’aurait pu passer !
Nos 155 longs pèsent 7500kg. On nous fit mettre quatre attelages de deux chevaux pour passer ce ponteau.
Dès que les deux premiers chevaux mirent le pied sur le pont, celui-ci s’effondra dans le boyau et la pièce de canon suivit le même chemin. Le lendemain, j’étais chargé de sortir le canon à l’aide d’une chèvre. La chaîne de la chèvre est courte, on monte de 0,50 m à la fois, à bout de course, il faut bloquer avec des madriers et recommencer. Cela a employé toute la matinée. Ensuite nous avons comblé le boyau et bien tassé la terre en recouvrant de bastaings. Je fis passer les canons, au pas, avec un seul attelage. Tout se termina bien.
Il se passa, dans notre secteur, le jour de l’attaque, une chose terrible qui engage fortement la responsabilité des Etats-Majors. Un réseau de barbelé devait être détruit en un point afin de laisser passer la cavalerie.
Malheureusement, lorsqu’un escadron se présenta, il y avait encore beaucoup de barbelés en place, non coupés. Les chevaux s’empêtrèrent, les cavaliers servirent de cibles aux Allemands et furent tous tués.
Ce que je cite, je l’ai vu personnellement ; car ma position de batterie se trouvait derrière ces barbelés à quelques mètres.
Un autre cas sur cette offensive de Champagne illustre le manque d’organisation du service sanitaire chargée de l’enlèvement des morts. Notre batterie était entourée de cadavres de fantassins tués le 25 septembre. Nos chefs demandèrent l’autorisation de donner une sépulture à tous, mais celle-ci fut refusée sous prétexte qu’il fallait réunir les pièces d’identité, et que nous n’en étions pas capables. Résultat, l’enlèvement des cadavres dura deux mois. Naturellement nous étions infestés de rats gros comme des lapins de garenne.

Pour cette fameuse attaque, nous inaugurions les cuisines roulantes dans notre régiment. Il y eut un côté légèrement comique. Les cuisines étaient dans le camp de Chalons où il n’y avait pas d’eau.
Les cuisiniers nous apportaient la soupe, le soir, à la tombée de la nuit. Le point d’eau se trouvait sur le passage du retour à Saint-Hilaire-le-Grand, les Allemands le marmitaient avec des gros calibres : ce n’était certes pas le paradis. Nos cuisiniers n’étant pas des héros ne nettoyaient pas la roulante, ils prenaient juste de l’eau dans leurs marmites.
A la fin, à force de mélanger les restes avec de la flotte, nous mangions : haricots, lentilles, riz, patates en un beau potage. Quant au café, il arrivait au galop, c’était du café « Marc ».
Après l’attaque du 6 octobre 1915, sans résultat sauf les victimes, nous partîmes au repos à Grugny, petit patelin de la Marne près de Farmes. Là, une épidémie de « morve » attaqua les chevaux du groupe, il fallut en abattre 150 sur l’effectif total qui était 450. Nous étions en décembre 1915, j’eus en fin ma première permission depuis le début de la guerre, c’est-à-dire près de seize mois, car à Cherbourg, il n’y avait pas de permissions pour Paris.
Dans le premier trimestre de 1916, nous participâmes à quelques attaques de moindre importance. Notamment la reprise de la Ville au Bois où M. Thellier, maire de Saint-Jean, fût fait prisonnier par les Allemands. Mon intermède comique se place à cette période. Notre roulante était sous un hangar complètement vide. Un matin, nous attendions le jus, comme il n’arrivait pas on envoya un camarade voir ce qui se passait. En arrivant, il vit le hangar écrasé sur le sol par le vent et nos braves cuistots enfouis et prisonniers, heureusement aucun n’était blessé. D’autres camarades nous aidèrent à les dégager, il n’y eut qu’un retard dans la distribution du café.
Au mois d’avril 1916, prise de position à Courcelles-Saint-Brice, sur les bords de la Vesle dans la banlieue de Reims, secteur très calme. Mon observatoire se trouvait dans une cheminée d’usine du faubourg de Laon à Reims.
Chose curieuse, la cheminée avait reçu un obus en 1914 à sa base et qui avait laissé un trou béant. Cela donnait à réfléchir : si un second obus suivait le chemin du premier l’observatoire perché à vingt ou vingt-cinq mètres de hauteur risquait de descendre plus vite qu’il n’était monté ! Mais rien ne se passa.
3 mai 1916. Embarquement à Muizon, direction Bar-Le-Duc et Verdun-la-Fournaise.
Débarqués à Bar-le-Duc, chemin à pied sur une route parcourue par un trafic intense : deux rangées de camions, parfois trois. Quant aux hommes à pied – dont nous étions – ils devaient cheminer dans les fossés. C’est cette route qu’on surnommera « La Voie Sacrée ». La population de la Meuse, saturée de troupes, refusait de nous loger dans les granges et renâclait pour nous donner de l’eau.
A Verdun nous laissâmes nos canons et allâmes remplacer nos camarades qui nous attendaient avec impatience. Lorsqu’ils nous virent approcher, ils quittèrent immédiatement leurs postes, nous laissant nous débrouiller avec cette nouvelle position.Depuis l’attaque de la Ville-au-Bois, j’étais Maréchal des logis. Comme nous étions peu nombreux, gradés et servants, je fis fonction de chef de section, c’est-à-dire que j’avais deux pièces sous mes ordres, la 3e et la 4e pièce.
Après examen de la position de batterie, nous constatâmes que la situation n’était pas brillante. Le bois dans lequel nous nous trouvions, le « Tillat » sur la rive droite de Verdun était saturé de gaz suffocant mêlé à l’odeur des cadavres. La batterie était continuellement marmitée par l’ennemi. Nous avions de très bons abris à sept ou huit mètres sous terre.
Chaque fois que nous devions tirer le minimum de personnel sortait des abris et fonctionnait rapidement. Malgré cela, il y eut des pertes dès le premier jour et ensuite tous les jours. Heureusement pour moi je partis en permission pour la seconde fois depuis le début de la guerre.
Pour aller en permission, il fallait aller à Pied jusqu’à Duguy. Six heures sur les plateformes d’un « tortillard » et arrivée le soir à Revigny. Nous étions seize mille. Chaque jour, il fallait attendre le départ des trains spéciaux jusqu’à cinq heures du matin (7). Inutile de dire que les Allemands bombardaient régulièrement la gare. Afin d’éviter les accidents, je m’installais avec quelques copains dans un fossé à l’extérieur de la ville et nous n’avons rejoint la gare qu’à l’approche du départ des trains, les ennemis ne tiraient pas à ce moment-là car notre aviation les gênait.Retour de permission, j’avais apporté un rôti de veau pour le partager avec les copains. Je retrouvais mes camarades bien déprimés. L’odeur des gaz les incommodait tellement qu’ils ne mangeaient presque plus. Beaucoup manquaient à l’appel car chaque jour il y avait des pertes. Nous ne mangeâmes pas le fameux rôti de veau.Quelques jours après mon retour, je me trouvais entre la 3e et la 4e pièce pour commander un tir, lorsqu’un obus ennemi éclata, juste au dessous de la 4e pièce, cinq hommes furent tués et déchiquetés. Cela prouve que le destin joue toujours et que j’étais protégé : deux secondes avant j’étais à côté de la 4e pièce, donnant des instructions. Le canon était passablement détérioré, il ne pouvait plus servir sans être réparé.
L’Etat-major, jugeant sans doute que nous avions trop de pertes donna l’ordre de transférer les trois pièces qui fonctionnaient encore dans une autre position à côté des casernes « Chevert » en haut de Bellerupt.
Notre départ du « Tillat » nous coûta encore des pertes, les Allemands ayant bombardé au moment où l’on mettait les attelages aux canons.
Comme j’étais le seul sous-officier connaissant l’artillerie et notamment la manœuvre de force, le commandant de batterie me chargea de récupérer la pièce détériorée afin de la conduire au Grand Parc d’Artillerie pour réparation.
En cette année 1916, nous étions pauvres en matériel, les Allemands en avaient trois à cinq fois plus, il fallait donc le ménager. Nous partîmes quinze hommes par groupes de trois afin de limiter les dégâts si un obus nous tombait sur la trombine. Arrivés sans accident, le plus difficile restait à faire. Il fallait équiper la chèvre sous le bombardement ennemi. Nous mîmes une journée pour mettre le tube sur un porte tube (3500 kg) et sortir l’affût (4000 kg) de la plateforme. Nous sortîmes les deux véhicules sur un chemin solide afin de pouvoir les évacuer rapidement. Lorsque les attelages, commandés par un sous-officier, arrivèrent les traits furent accrochés en trois minutes et aussitôt la petite troupe partit au galop, sans incident. Je rentrais à la batterie, rendre compte de ma mission. Le Lieutenant me félicita et me promit de me proposer pour la Croix de Guerre.
Dans la nouvelle position, le bombardement par l’ennemi continuait. Je me souviens d’un accident qui par chance ne fit pas de victime. Il faut savoir d’abord, comment fonctionne un obus. Avant de mettre l’obus dans le canon on visse une fusée sur l’ogive de l’obus. Au moment où la charge de poudre projette l’obus vers l’avant, par la force d’inertie, la fusée subit un premier armement. Lorsque le projectile arrive a destination, suite au choc avec le sol ou tout autre obstacle la fusée subit le deuxième armement lequel transmis par du fulminate fait éclater l’obus. Il existe des fusées plus ou moins sensibles. Notamment les fusées instantanées qui font éclater l’obus au ras du sol fauchant tout sur son passage et celles qui font éclater l’obus dès qu’il heurte un obstacle.
Nous venions de charger la troisième pièce, le tireur fit partir le coup, au même instant l’avant du tube éclata et fut projeté en avant où heureusement il n’y avait personne. L’accident incombe à l’usine qui a fabriqué l’obus. Le vérificateur du calibre des obus n’a pas fait son travail consciencieusement, le projectile était un peu trop gros.
Au départ du coup, la fusée a fonctionné normalement dans l’âme du canon, un arrêt de peut-être un millième de seconde a déclenché la seconde fusée et provoqua l’éclatement et de l’obus et du canon.
Les ouvriers qui fabriquaient des obus ne se doutaient pas qu’un moment d’inattention de leur part pouvait causer une catastrophe.
Deux jours après, le 30 juillet 1916, alors que je sortais de l’abri pour donner des ordres un obus de 210mm allemand éclata devant moi à deux ou trois mètres. Je fis un plat ventre magistral mais malgré tout un éclat avait traversé mon bras droit et la région deltoïdienne.
Aussitôt au poste de secours le « toubib » me fit un premier pansement ensuite je descendis à Bellerupt. Subissant une hémorragie, je m’assis sur un tas de cailloux, attendant le passage d’une voiture. Heureusement une auto avec des officier stoppa, ils m’emmenèrent à Dugny. Là, dans l’église, on me fit une piqûre antitétanique. De là je fus transporté à Vadelincourt et je m’offris deux jours de coma. Quand je me réveillais j’étais dans une tente, à ma gauche un camarade avait le drap tiré sur la figure, à droite un autre était à toute extrémité.
Comme réveil c’était plutôt macabre !
Au bout de quatre jours dans cet hôpital de toile on nous expédia de Revigny à Latrecy. Là des ambulances nous conduisirent à Arc en Barrois dans un hôpital temporaire dirigé par de riches canadiens. Je suis resté un mois environ, très bien traité par ces canadiens qui ne savaient quoi faire pour nous.
De là direction La Tour du Pin, hôpital de convalescence où je restais trois mois environ. Permission d’un mois à la maison. Retour au dépôt de Dôle, entre Noël et le jour de l’An 1917.
J’apprends la manœuvre du nouveau canon de 155mm Schneider à douilles. En janvier nous allâmes au Coudray, près de Chartres effectuer des tirs. J’étais chargé de l’instruction de la batterie et complètement aphone durant le stage.Partant de Dôle, nous rejoignîmes Château-Thierry pour préparer l’attaque du 16 avril 1917. Débarquement à Château-Thierry. Reconnaissance des positions de batterie près de Saint-Marc, au bord de l’Aisne dans un marécage presque inaccessible. Nous prenons position aussitôt car il va falloir tirer rapidement. Impossible de creuser des abris, l’eau étant presqu’au ras du sol. Nous couchons sous les tentes, il fait très froid, le sol est recouvert de neige. Les camions apportent les munitions dans le village de Saint-Marc, à cinq cents mètres de la batterie. Comme il faut tirer quatre cents coups par vingt quatre heures (obus de 155 pesant 41 à 42 kg plus les douilles) le génie nous installe une voie Decauville pour le transport des munitions. A la batterie nous avons des récupérés de la classe 1917 et des blessés d’infanterie. Mauvaise nourriture se composant de cheval tué. La soupe est faite à l’arrière, on nous l’apporte la nuit, nous la mangeons le lendemain. Conservée dans des marmites norvégiennes, le plus souvent le « rata » est couvert de moisissure. A ce régime les hommes très fatigués ne peuvent tenir le coup. Tous les jours on en évacue. A aucun moment nous ne sommes plus de douze à la batterie, gradés compris. Il faut toujours tirer 400 coups et ravitailler les pièces. Pour comble de malheur, la voie Decauville s’est enfouie dans la vase. Il faut effectuer le transport à l’épaule. Pour diminuer le nombre de voyages à Saint-Marc nous nous chargeons mutuellement un obus sur chaque épaule et parcourons les cinq cents mètres dans la boue.
Nos tentes sont à 50m derrière la batterie, mais personne ne les garde. Une relève d’infanterie passant dans le bois nous vole nos couvertures et notamment un colis que j’avais reçu de mes parents et que je n’avais pas eu le temps d’ouvrir. Les fantassins sont miséreux et n’hésitent pas prendre le bien d’autres miséreux.
Un soir en ravitaillant une pièce, je passe sous la bouche du canon lorsque mon tireur ne m’ayant pas vu fait partir le coup juste au dessus de ma tête. Depuis ce jour j’ai un sifflement dans l’oreille gauche.
Mais il faut signaler que les obus boches ne faisaient que peu de dégâts. Deux sur trois n’éclataient pas et allaient s’enfouir dans la vase. Les autres produisaient souvent un geyser.
Dès le déclenchement de l’attaque du 16 avril 1917 nous passons l’Aisne et le canal de Saint-Marc et mettons en batterie sur la route latérale à l’Aisne qui va de Loupire à Vailly. Le beau temps se met de la partie, nous sommes au sec, assez bien abrités de l’ennemi, dans ses anciennes positions d’infanterie derrière une colline. Il ne peut nous atteindre qu’avec des obusier – ce qu’il fait – et comme nos munitions ne sont pas abritées il en saute pas mal. Un jour un dépôt de grenades à cinq cents mètres de la batterie saute, cela fait un fameux feu d’artifice, il est recommandé de se coucher pour éviter les éclats.
Cette période est très mauvaise pour le moral. Les grosses pertes de l’attaque du Chemin des Dames écoeurent les fantassins qui sont de tous les coups durs, les malheureux. J’ai vu un régiment d’infanterie parqué dans un camp entouré de fils barbelés et gardé par des sénégalais.
C’était très triste !
Au mois de mai nous quittons cette région pour le secteur de Verdun. Nous nous installons dans les bois afin de tirer en direction de la côte 304. A cette époque j’étais sous-officier observateur, mon observatoire se trouvait dans un ancien boyau allemand, face à la côte 304, avec le village d’Ehre au pied. Le boyau n’était pas profond, il fallait marcher courbé en deux pour atteindre l’observatoire à la bouche d’une ancienne sape ennemie avec ouverture vers le front.
Un jour où j’étais en train d’observer un tir de réglage de ma batterie je vis à deux cents m dans le boyau trois officiers armés de jumelles, se promenant comme sur le boulevard, je leur fis signe de se baisser car on était visible à l’œil nu des positions de la côte 304 occupés par les Allemands. Un Général et deux officier d’Etat-major se présentèrent, je leur expliquai les raisons de mon signe. Ces messieurs ne s’en doutaient pas : le général me demanda des renseignement sur le secteur et cinq minutes après ils étaient partis.
Mais ceux d’en face ne trouvèrent pas cela à leur goût. Un quart d’heure après ils commencèrent à nous bombarder avec des 210 bien ajustés. Ils coupèrent nos lignes téléphoniques plusieurs fois et nous les réparâmes. Au bout d’un certain temps mon commandant de batterie me donna l’ordre de ne plus réparer et de me mettre à l’abri avec mon collègue. Nous avions reçu en sept heures 250 obus de 210. Heureusement la sape était solide mais les deux sorties étaient bouchées.
Avec mon camarade, ne voulant pas être enterrés comme des rats, nous décidâmes d’essayer de sortir. Après avoir dégagé la sortie avec nos mains, nous fîmes un bond de trente mètres sans être touchés. Après quelques bonds de ce genre dans la boue, nous étions hors de portée.
Nous rejoignîmes la batterie rencontrant en route notre commandant de batterie, venu voir si nous étions encore en vie. Une citation à l’ordre de la 73e division nous récompensa.
Pour l’attaque du mois d’août 1917, nous prîmes position dans le ravin de la Caillette, au pied du fort de Vaux. Un ravin bombardé comme je n’en avais jamais vu, pas un brin d’herbe ne poussait tant nous étions marmités. Heureusement nous avions de bons abris. Un jour, après un bombardement, le chef de la 3e pièce ne retrouva plus son canon, par contre sur la quatrième pièce il y avait cette troisième pièce baladeuse (3700 kg projetés à 12m de distance). Afin d’éviter de pareils incidents, l’Etat Major décida de nous faire changer de position. Nous nous installâmes sur l’emplacement du village de Fleury, à la sortie du ravin de la Couleuvre. Nous sommes restés là quatre mois, sans subir aucune perte. Tous les obus ennemis passaient par-dessus notre tête et tombaient dans le fond du ravin.
Un incident comique qui aurait pu être tragique se place à cette période. Nous avions laissé la pièce hors d’usage au ravin de la Caillette, le capitaine reçut l’ordre de le faire transférer au parc d’artillerie. Je fis comme l’année précédente : chèvre, canon et quinze hommes…Tout se passa bien, sans accident. Rien de bien marquant durant cette année.
Nous tirions beaucoup. Contrairement à l’année 1916 nous avions une sérieuse supériorité d’artillerie sur l’ennemi
J’allais à l’observatoire sur la côte 348 et au fort de Douaumont. A l’hiver nous allâmes au repos dans la région de Revigny. Au printemps 1918 nous étions dans le secteur de Toul, au milieu de la 1ere division Américaine (Observatoire près de Nevéant => ancienne frontière allemande)/
Au mois d’août 1918, ayant envie d’aller à l’arrière, je m’inscrivais pour l’Ecole d’Artillerie de Fontainebleau. Ayant de bonnes notes de la part de mes chefs je fus désigné. Je terminais la guerre à l’Ecole et fut promu Sous-Lieutenant.
Ensuite occupation dans la zone de Landau. Sans histoire. Sauf une petite anecdote amusante. Pour Noël 1918, désirant organiser un bon repas pour les hommes de la batterie, j’allais avec le brigadier d’ordinaire acheter des oies chez des paysans du Palatinat. Ceux-ci étaient très réticents pour les vendre. Enfin le jour de Noël, on mit les oies à cuire de très bonne heure. Après deux heures de cuisson, elles restaient dures comme du bois. Nous décidâmes de les couper et de les préparer en ragoût ce qui les rendit a peu près mangeables. J’eu par la suite l’explication. Les paysans de cette région élèvent les oies pour le duvet et les gardent plusieurs années ! Comment s’étonner qu’elles soient restées coriaces.
Au mois de mai 1919 retour au dépôt de Brest en passant par le fameux tunnel de Tavannes.
Vie de château sur les belles plages de la région. En particulier Morgat.
Libération à la fin du mois d’août.
Notes :
1) Notre section se trouvait à Manaucourt sur Seille dans un village non évacué, dans la cour du Château. Je fus logé chez de braves gens qui me soignèrent comme leur fils. Au bout de quelques jours les Allemands bombardèrent le village et ce sont les civils qui en supportèrent les conséquences. L’évacuation de la population fut décidée. Mes hôtes voulurent me laisser un lit complet, du linge de rechange, des légumes et de l’alcool. Mais peu de temps après leur départ un obus fit s’écrouler leur maison. Je couchais alors dans la cave du château.
2) Mes connaissances au point de vue ravitaillement ayant été appréciée à leur juste valeur on me désigna comme brigadier d’ordinaire pour toute la batterie au centre de Sivry. J’appliquais le règlement du mieux que je pouvais. C’est ainsi que le jour de mon arrivée le cuisinier du mess des sous-officiers vint, avec un broc, chercher du pinard à la roulante. Je lui demandais son bon du chef de batterie – bon qu’il n’avait pas. Durant toute la durée de mon service, les sous-officiers ne touchèrent que leur ration. Considérant sans doute que mon «zèle était excessif on me nomma brigadier observateur à la batterie de 155 long de Gendelincourt.
3) Le 16 mai 1915, déclaration de guerre de l’Italie aux Empire centraux, les cloches sonnèrent dans toute la région. Mon camarade voulut faire sonner les cloches de l’église de Nonrémy où se trouvait notre observatoire. Mais l’édifice était délabré. Il reçut une poutre sur la tête et fut évacué.
4) Bombardement continuel de Pont-à-Mousson – sans perte pour nous heureusement. Prise de position dans la Foret de Falq de nuit – nous nous couchons sur les feuilles et nous retrouvions le lendemain au jour à moitié enfouis dans la vase. Apres cet incident je me couchais sur un tas d’obus.
5) Concours de reptation : à celui qui irait planter un bâton au plus près des lignes allemandes.
6) De Saint Hilaire le Grand la Suippes est parallèle à la route sur environ 500m. L’Etat Major avait jugé bon de parquer les réserves d’infanterie sur cette bande de terrain au lieu de les camoufler dans le camp de Chalons. Les artilleurs boches qui échelonnaient toujours leurs tirs ne nous ont tué qu’un seul homme mais les malheureux fantassins « en réserve » se faisaient massacrer par les coups plus longs.
7) Lorsque le train de permissionnaire se présentait à Revigny, inutile de dire que nous nous précipitions à l’assaut des wagons. Il n’y avait pas de couloir entre les compartiments. Avec mes camarades nous avions réparti les vivres pour le voyage : l’un avait le liquide, l’autre le solide. Nous ne réussîmes pas à monter dans le même compartiment. De Révigny à Vaires-Torcy 9 heures de voyage et le compartiment était si rempli que je ne pouvais fouiller dans mes poches. A Vaires nous avons bu une bouteille de Bordeaux, qui, la fatigue aidant nous enivra. Heureusement je trouvais Papa à la gare et un « Noilly-cassis » me remit d’aplomb.
8) Sinon on voulait facturer le canon 75000 f au capitaine.
9) Au début, j’allais seul à la côte 348, mais le secteur était fortement marmité, je demandais au capitaine de m’adjoindre un camarade. Il parait que lorsque je devais partir en permission je faisais plus souvent des « plats ventres » au moment des bombardements.